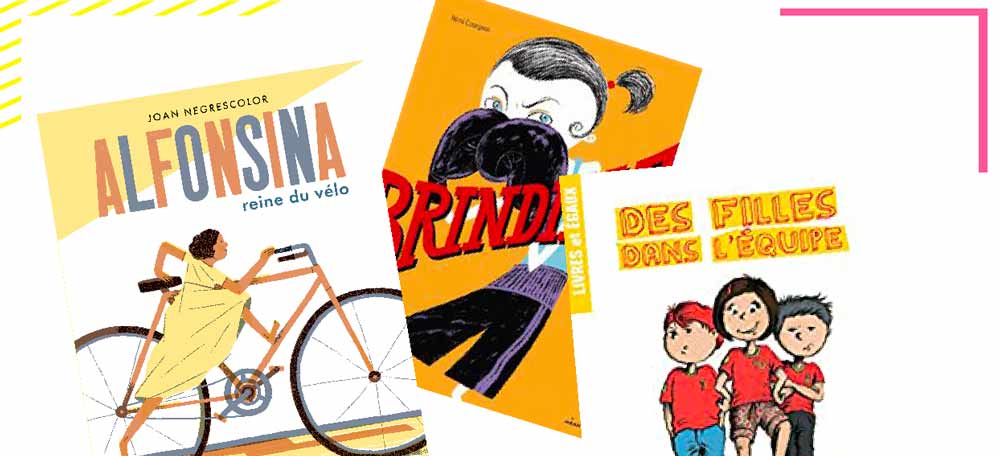Antoine Thépaut, maitre de conférence à l’INSPE de Lille, auteur d’une thèse sur les sports collectifs à l’école primaire, fait un tour d’horizon des recherches sur les contenus disciplinaires et les enjeux du processus d’enseignement apprentissage à l’école primaire. Ces recherches interrogent le statut scolaire de la discipline, statut qui reste à conforter.
Article paru dans le Contrepied HS n°14 – EPS à l’école primaire. Janv 2016.
L’EPS au niveau de l’école primaire a ne place peu affirmée aux contours incertains. L’horaire réglementaire n’est pas assuré en totalité. Pour Anciaux (1983) la raison principale de cet état réside dans la possibilité ou non pour le professeur d’école (PE) de « trouver une adéquation entre sa définition du processus éducatif et sa culture sportive ». Depuis, plusieurs recherches en didactique de l’EPS à l’école primaire ont été menées. S’il est difficile de savoir si elles ont fait bouger les lignes, elles ont permis une meilleure compréhension de la nature de cet enseignement et par delà, des raisons qui amènent parfois les PE à le percevoir comme une discipline difficile à enseigner.
Une description du processus d’enseignement apprentissage
Un premier ensemble de travaux, après l’étude fondatrice d’A. Lebas sur les activités gymniques à l’école maternelle (1983), vise à décrire le fonctionnement du processus d’enseignement apprentissage propre à la discipline, tel qu’il est mis en oeuvre au quotidien par les PE eux-mêmes, en se dégageant de toute visée prescriptive.
Ces recherches soulignent l’importance que l’on doit accorder aux savoirs et savoir-faire enseignés si l’on veut bien comprendre l’enseignement usuel. En traitant sous l’angle du fonctionnement du système didactique, elles permettent de dégager trois modèles.
Un modèle fondé sur l’enseignement des techniques sportives, des formes gestuelles issues de l’observation spontanée et mises à l’étude au cours d’une succession de situations d’apprentissage aux contenus très formels, sans véritable liens entre eux. Mobilisés dans des exercices répétitifs ils n’ont guère de sens pour les élèves, si ce n’est pour certains, le plaisir d’être en activité physique hors de la classe . Cette approche, caractérisée depuis longtemps, repose sur une conception cumulative des savoirs et mécaniciste des activités sportives.
Un modèle « éducatif » reposant sur l’enseignement de valeurs, souvent déduits de visées éducatives censées être développées par la pratique elle-même. Les objectifs éducatifs prennent l’ascendant sur la logique des actions efficaces. Ainsi en jeux sportifs collectifs il n’est pas rare de voir la passe entre partenaires privilégiée au détriment de la progression de la balle vers la cible adverse. Ailleurs, ce sont les savoirs être ou savoirs transversaux du socle commun qui sont privilégiés au détriment de la dimension stratégique du jeu (Amans-Passaga 2010). C’est oublier que les apprentissages corporels sont porteurs de valeurs et non l’inverse.
Un modèle autoadaptatif où les savoirs sont confondus avec l’activité motrice elle-même. Dès lors que l’élève pratique, respecte les règles du jeu et les consignes, qu’il « est actif » il est censé apprendre. Les contenus sont réduits à des tâches motrices et L’EPS revient à mettre les élèves en situation de pratiquer. Différentes recherches montrent des tâches aux critères de réussite le plus souvent implicites. Or, en l’absence d’une prise en compte des résultats de leurs actions, les élèves régulent leurs différents essais au hasard, laissant place à des procédures d’apprentissage spontanées. La réussite dans la tâche motrice l’emporte sur l’enjeu d’apprentissage (Thépaut, Léziart 2008).
Ces trois modèles entraînent de fréquentes ruptures du contrat didactique, le plus souvent à l’insu même du PE. Les études soulignent la nécessité d’une réflexion sur les contenus d’enseignement. Ceux-ci, souvent conçus comme une simple « réduction » (en taille, en nombre de joueurs, en distance, en intensité) des contenus enseignés au collège. En l’absence d’un approfondissement épistémologique, ceux-ci semblent inabordables au PE qui n’ose pas enseigner l’EPS et constituent un frein à l’enseignement de la discipline. La possibilité de concevoir des contenus d’enseignement propres à ce niveau de scolarité doit, au contraire, s’inscrire dans le cadre de la polyvalence sans lequel il n’est jamais possible d’en comprendre les déterminations.
La spécificité des contenus de l’EPS à l’école maternelle
L’école maternelle exacerbe deux sources de questionnement : la nature disciplinaire des contenus en même temps que le rapport au développement de l’enfant. Une première approche a été de les déduire des recherches sur le développement moteur de l’enfant (1970/1990). Les connaissances produites selon cette perspective se sont révélées peu utiles pour enseigner. Le développement moteur de l’enfant n’est pas une donnée théorique s’imposant à la réalité, il n’existe pas indépendamment des techniques corporelles issues des problèmes posés et résolus dans chacune des APSA (Cf. Rochex 2014, Contrepied n° 10). Ce constat soulève alors la question des pratiques de référence à l’école maternelle. Longtemps cantonnés aux jeux de la culture enfantine, divers travaux soulignent leur faible potentiel d’acquisition d’habiletés motrices. C’est la référence aux APSA (pris en son sens large et non pas à la seule définition parlebasienne des sports) qui fournit des éléments permettant aux élèves de donner du sens à leur activité en même temps que des perspectives de progrès moteur et ce dès l’école maternelle (Pontais 2014). Cependant, l’inadaptation des activités sportives aux enfants de deux à cinq six ans, patente tant au plan morphologique, cognitif (compréhension du sens des activités, des règles du jeu…), psychologique (rapport à la règle, à la morale, rapport aux autres enfants …) nécessite un long processus de transposition.
Le rapport au langage
Devant l’importance de la maîtrise de la langue dans le développement du sujet, les textes officiels insistent sur la contribution de chaque discipline au développement de cette faculté. Mais s’agit-il d’activité physique comme occasion de parler, d’exprimer ses émotions ou d’activité langagière comme levier du développement des apprentissages moteurs ? La frontière est étroite et les confusions possibles nombreuses. En l’absence de contenus précis, le risque de tomber dans le verbiage au détriment de l’agir est certain. Quelques études centrées sur les phases dites de « formulation » le montrent (Thépaut 2012, 2014). Néanmoins des procédures originales et prometteuses apparues d’abord au collège et lycée (le débat d’idées Grehaigne 2012, la co-élaboration des règles d’action en dyade Darnis, Laffont, Menaut 2007, l’argumentation dans les pratiques de coaching N. Mascret) s’étendent à l’école élémentaire (Wallian, Chang) et maternelle (Prevel). Elles exploitent de façon avantageuse la polyvalence. Le langage, en même temps que développement des capacités langagières permet l’inscription dans une activité technique définie comme activité volontaire, reproductible à même de dépasser les procédures d’apprentissage spontanées.
Les pratiques de partenariat
Alors que divers textes officiels le rappellent régulièrement, l’enseignement de l’EPS est sous la responsabilité du PE titulaire de la classe, l’étude des pratiques ordinaires permet d’interroger la participation d’intervenants extérieurs. Les recherches soulignent ici, plutôt une discontinuité des savoirs enseignés, une absence d’articulation des actions didactiques et une juxtaposition des deux systèmes didactiques. Il en résulte un « flottement des élèves entre les références » source de rupture de contrat didactique et une collaboration plus virtuelle que réelle (Devos & Amans-Passaga 2010).
Les pratiques de formation
Un autre groupe de recherches souligne combien l’absence d’une référence précise à des contenus d’enseignement clairement identifiés naît d’une connaissance restreinte des APS. Or, du coté de la formation initiale il a toujours fallu composer avec des volumes horaires faibles. Quel niveau de maîtrise épistémologique et technique des savoirs, minimal pour conduire les apprentissages requis par les savoirs scolaires ? Quelle influence a eu l’allongement de la formation universitaire à Bac +5 ? Les PE sont -ils plus et mieux formés que ceux recrutés au niveau du baccalauréat (avant 1980), au niveau DEUG (1982-1990) ou niveau licence (1990-2008) ? Par ailleurs la formation à l’enseignement du français, des mathématiques a-t-elle des incidences sur celles à enseigner l’EPS ? Quelles approches transversales de la formation ? Quelles priorités en formation initiale et quelle poursuite en formation continue ? Il existe peu de travaux à ce niveau. Une recherche sur la création d’outils didactiques a pu mettre en évidence une utilisation différenciée de ceux-ci par les PE, selon leur origine, leur parcours universitaire, leur culture sportive (Pontais & Brière 2014). Elle souligne la nécessité d’une prise en compte des problèmes de gestion de classe en relation avec le pilotage des apprentissages. Les recherches peuvent aider à concevoir la formation prenant appui sur l’alternance en abordant simultanément les apprentissages professionnels de conduite de classe à bien des égards spécifiques en EPS (Blanchoin 2013) et ceux liés à l’avancée des savoirs dans les séances.
Références bibliographiques
- Amans-Passaga C. (2010). L’articulation de l’action didactique d’intervenants associés en EPS à l’école primaire, Education et Didactique, vol 4, n°1, 25-50.
- Amans-Passaga C. (2013). Analyse didactique de situations de partenariats professeur / intervenant, en EPS à l’école primaire. Recherches en Didactiques 16, PUS, Villeneuve d’Ascq, p.43-58.
- Anciaux M. (1983). Analyse des résistances des instituteurs en EPS. L’école et la Nation, 337, p. 40-44.
On peut y mentionner également Baillat G. Guillon R. (1998) Polyvalence et EPS dans l’enseignement du premier degré. Contrepied n°3. - Blanchouin A. (2013). Former les professeurs d’école au temps et à l’espace de l’EPS. .
- Blanchoin A. (2015). La journée de classe de l’enseignant polyvalent du primaire : étude du cours d’action quotidien en Cours Préparatoire sur une année scolaire. Paris. Thèse non publiée.
- Chang W., Wallian N., Nachon M., Grehaigne JF. (2006). Pratiques langagières et stratégies d’action : vers une approche sémioconstructiviste du basket-ball à Taïwan, STAPS Vol 27, 72.
- Darnis F., Lafont L., Menaut A. (2007). Interactions verbales en situation de co-construction de règles d’action au handball : l’exemple de deux dyades à fonctionnement contrasté, eJRIEPS n° 11, Besançon, Iufm Franche-Comté, p. 56-76.
- Devos O. (2006). Rapports aux savoirs des professeurs d’école et développement des contenus en éducation physique. Etude comparée de quatre cycles de basket-ball au cours moyen. Toulouse. Thèse non publiée.
- Devos O., Amans-Passaga C. (2010). PE et intervenants extérieurs en EPS : nature de la collaboration et incidence sur les contenus enseignés. in Amans-Passaga, C. (et all), L’intervention en sport et ses contextes institutionnels : cultures et singularité de l’action, Rodez, Edition Presses du Centre universitaire Champollion, p. 133-138.
- Grehaigne J.F. Deriaz D. (2010). Le débat d’idées, in Grehaigne J.F. (cord) Configurations du jeu : Débat d’idées et apprentissage du football et des sports collectifs, Presses Universitaires de Franche-Conté, 111-121.
- Lebas A. (1993) De la gymnastique sportive à l’activité gymnique en éducation physique. Une recherche d’ingénierie didactique au cycle des apprentissages fondamentaux de l’école primaire. Caen. Thèse non publiée.
- Pontais C. (2009). EPS : Quelle culture pour mieux apprendre ? In Passerieux C. (dir), La maternelle, première école, premiers apprentissages, Paris, Chronique Sociale, pp. 145-152
- Pontais C. (2014). En EPS des situations fonctionnelles et signifiantes pour les élèves. In Passerieux C. (dir.), Construire le goût d’apprendre à l’école maternelle, Paris, Chronique Sociale, p. 147-173.
- Pontais C., Briere-Guenoun F. (2014). Compréhension des modes de fonctionnement d’enseignant-e-s dans l’enseignement de l’EPS à l’école primaire et perspectives pour la formation. L’exemple de la gymnastique rythmique (GR) à l’école primaire. EJRIEPS, 32.
- Rochex J.Y. (2014). De la performance à l’école. Contrepied 10.
- Roustan C (2003), A propos de la transposition didactique et de la modélisation du badminton à l’école élémentaire : de la recherche à la pratique, eJRIEPS n°4, Besançon, Iufm Franche-Comté, p. 38-53.
- Thépaut A., Léziart Y. (2008). Une étude du processus de dévolution des savoirs en sports collectifs. Activité des élèves et type de contrat à l’école élémentaire (cycle 3), STAPS n°79, p. 67-80.
- Thépaut A. (2010). Communications verbales et interactions langagières au cours de l’enseignement des jeux sportifs collectifs à l’école élémentaire (Cycle 3) in Amans-Passaga C. (et all), L’intervention en sport et ses contextes institutionnels : cultures et singularité de l’action, Rodez, Edition Presses du Centre universitaire Champollion, p. 233-239.
- Thépaut A. (2012) Règles du jeu et régulations du maître : exemple de l’enseignement des jeux sportifs collectifs à l’école élémentaire, in Léziart Y., Cabagno G., Loquet M., Trohel J., La règle sportive, P.U.B. Bordeaux.
- Thépaut A., Léziart Y. (2013). Performances et apprentissages disciplinaires en éducation physique et sportive. Une étude des performances didactiques en jeux sportifs collectifs à l’école élémentaire. e-JRIEPS n°28, p. 25-60.